Résilience, crise, nature, développement durable, transition, croissance verte … quels sont les mots piégés, usés, manipulés, détournés ou au contraire efficaces, quand il s’agit de parler d’écologie ? Comment nommer, pour faire prendre la réelle mesure de la situation ? Décrypter les enjeux et les représentations que véhiculent les mots, c’est le travail de Julien Rault. Maître de conférence en Langue et Littérature française à l’Université de Poitiers, il est spécialisé en lexicologie, soit dans l’étude des mots, de leurs sens et de leur utilisation. Entretien.
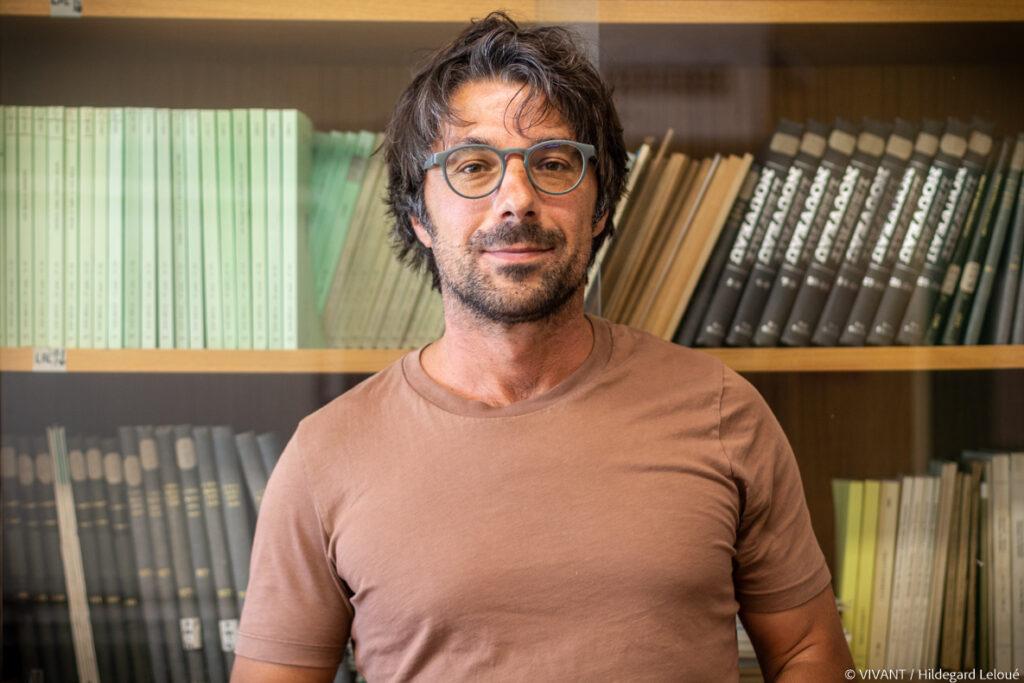
Il y a des expressions qui reviennent systématiquement, pour parler de l’écologie. C’est ce que vous appelez les “mots fatigués”, qui ont perdu de leur force et de leur efficacité. Pouvez-vous donner un exemple ?
On peut, par exemple, réfléchir à la question de la « crise ». On a beaucoup parlé de crise climatique, de crise environnementale, de crise de la biodiversité … Le mot crise est plutôt adéquat, au vu de la situation écologique actuelle : il renvoie à quelque chose d’urgent, de paroxystique et d’intense. Cependant, c’est un mot à double facette, qui peut provoquer deux effets opposés. Un effet de mobilisation, certes, mais aussi un effet de sidération. La crise étant un concept assez intimidant, le mot peut inhiber, faire peur, anesthésier la conscience critique.
Toutefois, le véritable problème de ce mot, c’est son omniprésence. Il est déjà partout, dans tous les domaines de la vie économique, sociale, politique et affective, et ce depuis des décennies. Dans les années 70, cela faisait rire Michel Foucault qu’on utilise encore le mot crise, car il le trouvait déjà vide et creux. Edgar Morin aussi, à la même époque, soulignait que le mot était devenu soporifique, qu’il n’avait plus aucun effet à force d’être tordu dans tous les sens, qu’il endormait au lieu de réveiller les consciences. Donc le risque, en employant le mot crise pour l’environnement, la biodiversité ou le climat, c’est d’entretenir l’idée qu’il s’agit d’une crise parmi les autres, au même niveau que la crise financière, la crise au Parti Socialiste ou la crise de la quarantaine, alors que fondamentalement, il s’agit de LA crise, celle qui absorbera tout.
Voilà donc typiquement un exemple de mot fatigué, qui a fini par se désémantiser, perdre de sa vigueur à force d’être utilisé. C’est regrettable, car l’étymologie du terme est parfaitement adaptée à la situation écologique. En grec, krinein signifiait “décider”, “juger” et était essentiellement employé dans le champ de la médecine, en référence au moment décisif de la maladie : l’étape qui précède soit la guérison, soit la mort. Le concept était aussi utilisé dans le discours juridique, où la crise renvoyait au verdict. À l’origine, le mot désignait donc un événement bref, un instant T crucial, alors qu’aujourd’hui, la crise correspond plutôt à un état, un régime permanent.
Et à l’inverse des mots “fatigués”, il y a donc les mots “en forme” ?
Oui, pour contrer les mots usés, on va tâcher de les remplacer par des mots nouveaux, plus vigoureux, qui pourront lutter plus efficacement. À l’heure actuelle, pour pallier l’affaiblissement sémantique et pragmatique du mot crise, on va par exemple entendre parler de “catastrophe”, voire de “cataclysme”. Cela relève déjà d’un positionnement différent, parce que étymologiquement, la catastrophe, c’est ”le dénouement”, ”la fin” (dans la tragédie, la catastrophe correspond à la mort).
Toujours dans cette idée de crise, de catastrophes, j’ai entendu il y a peu l’expression d’un environnementaliste, Rob Nicholson, qui parle de ”violence lente”. Le terme est intéressant, parce qu’il remet sur le devant de la scène ce qui se passe derrière, de façon invisible, lente et sous-jacente, tout en insistant sur la très grande violence que cela génère. Des exemples de violence lente, ce sont tous les agents polluants qui sont utilisés, mais dont les effets dévastateurs et délétères ne se manifesteront que des années plus tard.
Avec ces exemples, il me semble que l’on perçoit bien que la terminologie se renouvelle en permanence, dans une quête constante d’expressivité et d’adéquation la plus fine possible du mot à la chose, pour essayer de marquer les esprits et de lutter plus efficacement.
Parmi ces expressions, certaines sont à double-tranchant. C’est ce que vous appelez des mots “piégés” ?
Oui, en ce moment, une réflexion très intéressante se développe autour du mot ”nature”, le piège étant que cette notion s’inscrit forcément dans un diptyque : qui dit “nature” dit “culture”. Cela laisse entendre que l’on pourrait penser ces notions de façon distincte, comme si l’une était indépendante de l’autre, et donc, pouvait exister sans l’autre. Or, cela nie complètement l’interconnexion, les liens de dépendance entre nature et culture que des penseurs majeurs comme Philippe Descola ou Bruno Latour ont, par exemple, largement théorisés.
Et puis, on peut même aller plus loin en sondant l’imaginaire que ce mot charrie avec lui. Si on parle souvent de “mère nature”, faudrait-il en déduire que la culture serait, par opposition, du côté du père ? Cet implicite douteux montre bien à quel point les mots sont “habités”, ce dont on ne prend pas forcément conscience de prime abord.
Face aux problèmes posés par le mot “nature”, on entend aujourd’hui davantage des mots comme “terrien”, qui permet d’envisager l’ancrage à la terre avec un petit et un grand T. Ce mot permet aussi de favoriser l’émergence d’une réflexion autour d’une “éthique de la terre”, ce qui implique de redéfinir toutes les questions de justice. L’écrivain Camille de Toledo emploie, par exemple, l’expression de “soulèvement légal de la terre”. Dans ses œuvres, il défend le principe selon lequel la justice ne devrait pas uniquement concerner les humains, mais aussi le milieu dans lequel ils interviennent et qui les accueille. Il se bat ainsi, depuis plusieurs années, pour que la Loire soit considérée comme une personne juridique, avec des droits et un statut propre. C’est d’ailleurs déjà le cas pour un certain nombre de fleuves dans le monde qui ont acquis ce statut de personnalité juridique.
Donc ce mot, la ”terre”, revient beaucoup, il me semble. Bruno Latour, qui est un sociologue, anthropologue, philosophe, publiait en 2017 un essai qui posait la question suivante : ”Où atterrir?”. Il reprenait, remotivait ce terme de ”terre” qu’on va retrouver aussi dans plusieurs médias qui traitent de l’écologie, comme Reporterre ou Le Terrien.
Et puis, on constate que l’avènement d’un nouveau mot va permettre aussi de créer de nouveaux clivages : au couple “nature / culture” on peut désormais opposer “terriens vs. destructeurs”, comme on le retrouve notamment dans les discours des partisans de l’écologie intégrale.
Qu’en est-il du mot “vivant” ?
Dans ce même ordre d’idée que “terrien”, le mot vivant est très significatif. L’adjectif “vivant” est devenu un nom : “le vivant”, au fil du temps. En lexicologie, quand un terme change de catégorie grammaticale tout en conservant son sens, c’est ce qu’on appelle une dérivation impropre. “Vivant” est donc devenu un nom qui, là aussi, témoigne de cette volonté de penser plus globalement notre rapport au monde, de considérer davantage les interdépendances entre les écosystèmes au lieu d’opposer humains et nature (une réflexion notamment menée par le philosophe Baptiste Morisot).
Dernièrement, il y a aussi eu une prise de position très forte des diplômés d’AgroParisTech lors de la cérémonie de fin d’année. Un discours très éloquent a été prononcé de la part de celles et ceux qu’on appelle les agro-bifurqueurs, qui refusent de perpétuer le système et de suivre la voie tracée, en pointant le fait que les innovations techniques et scientifiques ne sont jamais neutres politiquement. Une jeune femme a notamment évoqué une formation qui “pousse à participer aux ravages sociaux et écologiques“, du fait que l’agro-industrie mène une “guerre au vivant“. On voit bien la dimension beaucoup plus globale et inclusive que prend le terme “vivant”, sans même parler d’ailleurs de la métaphore de la guerre qui, ici, semble intervenir de façon tout à fait pertinente, en réactivant la dimension de violence frontale.
Ces mots sont souvent mis sur le devant de la scène, au service de toutes sortes d’argumentations. Quels sont les mots ou les expressions qui ont tendance à neutraliser le débat ?
On pourrait en effet envisager une deuxième catégorie de mots piégés, qui seraient “les mots qui neutralisent“ ou “les mots du statu quo“. La plus emblématique de ces formules est sans doute celle du “développement durable“, que l’on peut envisager sous la forme d’un oxymore. Le sociologue Bertrand Méheust a justement publié un ouvrage à ce sujet en 2009, La politique de l’oxymore, qui pointe cette tendance actuelle à produire des formules comportant deux messages en même temps, prônant une chose et son contraire ; un peu comme « la guerre, c’est la paix » du 1984 de George Orwell. Ces formules produisent, de fait, ce qu’on pourrait appeler des injonctions paradoxales, des incitations à penser en même temps deux choses opposées. Elles ont pour effet d’empêcher toute forme de contradiction, d’anesthésier la conscience critique.
Quel lien avec le développement durable ? Le développement, on le sait, c’est l’autre mot de la croissance. Or, comment concevoir une croissance infinie dans un monde dont les ressources sont finies ? Bertrand Méheust invoque à ce sujet le concept de saturation. Il explique qu’un système ne se transforme que lorsqu’il est arrivé au bout, à saturation, et qu’avec des formules de ce type, on ne pourra envisager une réaction que trop tard, au moment de la catastrophe finale. La formule “développement durable” a donc rencontré un petit succès, dans les discours de celles et ceux qui ne tiennent pas vraiment à ce qu’on remette en cause le cadre de pensée et de développement qui est le nôtre aujourd’hui, qui pensent que l’on peut trouver des solutions à l’intérieur du système productiviste, capitaliste ou néolibéral.
Dans cette même idée, la chercheuse en analyse du discours Alice Krieg-Planque s’est penchée sur l’emploi de cette expression. Elle considère le “développement durable” comme un « opérateur de neutralisation de la conflictualité. » Autrement dit, la formule intervient particulièrement dans des tournures concessives, multipliant les “tout en” (par exemple, “Il faut tenir compte du développement durable, tout en maintenant nos impératifs économiques“, “il faut aller dans le sens du développement durable, sans pour autant sacrifier nos objectifs de croissance”, etc.) On retrouve aussi des verbes tels que “allier“, “conjuguer“, “concilier“ ou des marqueurs comme “mais“, “cependant“ ou “toutefois“. Leur emploi démontre que la formule de “développement durable” sert à tenir des discours neutralisant la conflictualité, puisqu’il s’agit toujours d’articuler des impératifs économiques et des enjeux environnementaux en faisant, la plupart du temps, passer ces derniers au second plan.
On décèle, derrière ces expressions qui fleurissent, les stratégies discursives qui sont à l’œuvre. Développement, c’est un mot “paravent“ qui a permis d’éclipser le mot “croissance“, trop coloré idéologiquement, car marqué du sceau de l’économie néolibérale. Même si on y ajoute l’adjectif “vert”, on constate que l’expression “croissance verte“ n’a pas pris, parce que sa contradiction est trop évidente. C’est assez dommage quand on y pense, puisque la croissance, avant d’être confisquée par le champ de l’économie, était un très joli mot. La croissance, c’est aussi l’épanouissement du vivant, de nos enfants… Pourtant, aujourd’hui, on ne peut plus évoquer le mot “croissance“ sans penser à l’économie de marché. La “décroissance“ a été invoquée pour s’opposer à cette idée-là (et l’expression “décroissance soutenable“ pour créer une formule antithétique à “développement durable”). L’expression n’a pas vraiment fonctionné, non plus. C’est sans doute dû à sa part de négativité, induite par le préfixe “dé-“. Il est difficile d’adhérer à une conception qui se définit d’abord par la négative.
À propos de préfixes omniprésents, “éco-” apparaît maintenant greffé à des termes issus de tous les domaines, du marketing à l’industrie en passant par la politique. Comment analysez-vous cette appropriation ?
Effectivement, il y a des préfixes comme cela qui jouissent d’un certain succès. Le préfixe éco- intervient essentiellement dans des termes comme “éco-responsable”, “éco-gestes”, “éco-citoyen”. D’après moi, cela participe à un mouvement global qui consiste à faire reporter sur l’individu, tout en conférant une certaine dimension psychologisante, des enjeux socio-politiques et socio-économiques. Je prendrai deux exemples par rapport à cela : le mot “résilience“ et le mot “responsable“.
Le terme très à la mode en ce moment, tant sur le plan social qu’environnemental, c’est la résilience. C’est particulièrement catastrophique, du point de vue des présupposés, puisque cela contribue à individualiser des enjeux collectifs, économiques et de société. On le sait, le terme de résilience a été popularisé en psychologie par le neuropsychiatre et psychanalyste Boris Cyrulnik et il indique la capacité pour un individu, dans la sphère de l’intime, à surmonter un traumatisme. Appliqué à l’écologie, ce terme permet de nier complètement les responsabilités collectives et politiques, d’évacuer des responsabilités systémiques. C’est pourquoi il me semble que la résilience, c’est un peu la fin de la résistance collective.
C’est le même enjeu avec l’adjectif “responsable“, que l’on retrouve essentiellement appliqué au champ de la consommation, à la question du tourisme ou du tri sélectif, par exemple. Il existe un très bon article de Socialter à ce sujet qui répertorie les mots nuisibles et qui évoquait ce terme de responsabilité. C’est un peu la même chose que pour résilience : on rejette la responsabilité sur l’individu. C’est peut-être aussi une façon de miser, en étant très optimiste, sur notre capacité future et celle des écosystèmes à surmonter les traumatismes. Mais aurons-nous vraiment la possibilité d’être résilients face à ce qui risque fortement d’arriver ? On peut donc voir aussi, au-delà la psychologisation et de l’individuation, une forme d’euphémisation à l’œuvre derrière ce terme.
D’autres mots servent aussi à atténuer la réalité, l’urgence de la situation. Il existe par exemple tout un débat autour du terme de “transition”. Doit-on continuer à parler de transition écologique, plutôt que de transformation, voire de révolution ?
Le terme de “transition” est abondamment utilisé, on le retrouve d’ailleurs dans deux ministères : le ministère de la Transition énergétique et le ministère de la Transition écologique. On peut se demander s’il ne s’agit pas d’un terme euphémisé, d’un leurre pour continuer à nous faire croire qu’un changement lent, inscrit dans la continuité, serait encore possible. Ça va dans le sens de ce qu’on appelle le techno-solutionnisme, un mot apparu récemment pour désigner la croyance dans le fait que la technologie et le progrès finiront par nous sortir d’affaire. La transition a donc deux implicites : d’abord, celui d’une foi dans le progrès et les avancées technologiques. Ensuite, celui de laisser la possibilité d’additionner les énergies, car la transition n’implique pas de remplacer radicalement les énergies polluantes par d’autres. Et on le voit très bien en ce moment, la part des énergies renouvelables ou durables augmente, mais celle des énergies carbonées également (le charbon en Allemagne par exemple). Pour contrer ce terme trop imprécis et mou, Edgar Morin revendiquait notamment celui de “métamorphose” qui implique beaucoup plus de radicalité dans la façon de concevoir les choses.
Les mots peuvent-ils aussi être utilisés pour discréditer, amoindrir l’importance de la lutte écologique ?
C’est très intéressant, parfois même amusant, d’analyser les termes qui sont utilisés pour dénigrer le combat et la prise de conscience écologique. Parmi les termes qui fleurissent pour discréditer les discours contraires à la doxa libérale, on trouve le mot “réalisme”. Pendant très longtemps, les écolos n’étaient pas considérés comme réalistes. On continue d’ailleurs de leur reprocher cela : prendre position contre le nucléaire, ce n’est pas réaliste. Dans le même sens, les “climato-sceptiques” ont souhaité être considérés comme des “climato-réalistes”, ce qui implique une posture moins négative, plus pragmatique.
À l’inverse, d’autres personnes commencent à utiliser le terme beaucoup plus radical de “climato-négationniste” pour mieux traduire, en convoquant un imaginaire historique et culturel très fort, la puissance du déni et le caractère dramatique de ces doctrines et de ces discours (“sceptique” n’étant pas très adapté au regard de la gravité de ce qui est nié). Mais il y a aussi une possibilité d’un retournement de stigmate : ainsi, le mot “réalisme” est très employé à présent dans les discours écologistes. On parle désormais “d’écologie réaliste” ou de “réalisme environnemental”. Car les mots ne sont jamais complètement et définitivement l’apanage d’un camp. Il y a la possibilité de les récupérer, de les resémantiser, de leur redonner de l’efficacité et de les doter d’une dimension performative nouvelle. Le réalisme, aujourd’hui, se trouve sans doute davantage du côté des travaux et des discours du GIEC.
On peut attaquer les personnes engagées pour la défense du vivant sur leur réalisme, mais aussi “hystériser” leurs positions, les comparer à des extrémistes…
Un phénomène amusant et intéressant à ce sujet, c’est justement les constructions lexicales que l’on retrouve dans les discours de celles et ceux qui ont violemment attaqué les élus écologistes. Des discours qui se focalisaient, en premier lieu, sur les petites polémiques idiotes : le Tour de France qui serait machiste et polluant, le sapin de Noël supprimé à Bordeaux ou encore l’avion qui ne doit plus constituer un rêve pour les enfants. On a ainsi été témoins de Unes de magazines très féroces sur l’écologie ou son arrivée au pouvoir, comme sur le parti Europe Écologie les Verts. On a pu observer des métaphores très signifiantes dans ces discours, mais qui ne datent pas d’hier, certaines de ces expressions étant déjà utilisées dans les années 1970 et 1980. Parmi ce florilège, on retrouve le “djihadisme vert“ (une expression utilisée par Xavier Beulin, ancien président de la FNSEA) ou encore “ayatollahs de l’écologie“ (une formule qui a été reprise récemment par Eric Dupond-Moretti). On parle aussi de “terrorisme écologique“, d’“intégrisme vert“, de “fatwa contre les automobilistes“ (rire). Ce phénomène rhétorique est intéressant parce qu’il est constant. Quand il s’agit de discréditer et de faire peur, on convoque l’étranger, essentiellement l’islamisme. Eric Zemmour, il y a peu, est allé encore plus loin dans le parallèle en associant explicitement le vert de l’écologie au vert de l’islam.
On le voit, tous les termes employés appartiennent au même univers de référence et ont donc des effets très “dysphémisants”, autrement dit, ils aggravent le caractère d’une chose, à l’inverse d’un euphémisme. Présenter l’écologie comme un autoritarisme, un fanatisme, un terrorisme est, pour un certain nombre, le meilleur moyen de discréditer les discours et les actions de l’écologie politique, surtout quand elle accède au pouvoir.
Dans le discours réactionnaire, on a remplacé le communisme par l’islamisme : on dénonçait le “judéo-bolchévisme“ à l’université dans les années 1930 alors qu’aujourd’hui, on vitupère contre “l’islamo-gauchisme“ qui gangrène les universités. C’est une question de génération, il me semble. Par exemple, Gérard Collomb en 2011, a notamment parlé de “khmers verts”. L’univers de référence est plus ancien, mais remis au goût du jour régulièrement pour réactiver cet imaginaire anti-communiste. C’est sans doute volontaire : les jeunes générations, qui n’ont pas forcément la référence, ne font pas partie du public-cible de ces formules. C’est la même chose pour cette magnifique métaphore fruitière qu’est la « pastèque » (sous-entendue : verte à l’extérieur, rouge à l’intérieur) que l’on voit refleurir dernièrement, mais qu’utilisait déjà Jean-Marie Le Pen en 1989.
Comment améliorer sa façon de parler de la situation écologique, employer des termes plus justes ?
Il me semble que cela tient déjà à une question de vigilance, en étant conscient des termes que l’on emploie. Un exemple tout bête, c’est celui du réchauffement climatique. Une telle expression tend des perches à l’émergence d’un discours contradictoire, tel que « il fait beau / il fait -2°c, super le réchauffement climatique ! » et autres réflexions naïves. On va donc préférer la formule de “dérèglement climatique”, qui permet de reconnaître qu’il y a effectivement un réchauffement global des températures, tout en permettant de devancer ces contre-arguments de paresse ou d’idiotie que l’on peut entendre parfois.
Il faut prendre conscience du fait que les mots ne sont jamais neutres, ils ont toujours des présupposés, ils sont “habités“ du fait d’avoir été utilisés, comme l’indiquait le philologue russe Mikhaël Bakhtine. Il n’existe pas de termes vierges : chaque mot charrie avec lui son imaginaire, ses connotations, son univers de référence ; les mots tiennent en eux-mêmes des discours, qui permettent ensuite d’en tenir d’autres.
Propos recueillis par : Hildegard Leloué
Photos : Hildegard Leloué



